Bernard CORDIER, pilote puis trappiste,
le Père BAUDOIN par lui-même
Biographie manuscrite transcrite et éditée par Henri Eisenbeis
alias Lepeps.
Cette transcription respecte les intentions de l'auteur.
Son droit moral est, bien entendu, intemporel.
J'aurais pu naître
en Afrique ou dans une fourmilière d'Asie et non pas en France.
C'est pourquoi je crois à une certaine prédestination. En
fait, c'est à Lyon que je suis né le 3 mars 1912, dans une
famille bourgeoise, coté paternel des magistrats de Franche-Comté,
coté maternel, les Valentin Smith de Trévoux.
A ma naissance ma mère avait épinglé à mon
berceau la généalogie des Marquis de Montrichard (mon arrière
grand mère, grand père?) famille de Franche-Comté
remontant aux croisades et qui s'étaient alliés à
la famille de Saint Bernard et c'est pourquoi je fus prénommé
Bernard. En 1919 ma mère tombe très gravement malade à
la suite d'une fausse couche et d'une fièvre puerpérale.
Elle était abandonnée par les médecins dans le coma
et fut soudainement hors guérie.
Bien plus tard, elle me raconta qu'elle avait eu l'impression d'être
entraînée dans un tunnel pour déboucher dans une lumière
merveilleuse et un ange (ou le Christ) lui demanda si elle voulait rester
là. C'était tellement beau qu'elle souhaitait y rester mais
le souvenir de ses trois petits enfants la retenait et l'ange lui permit
de revenir sur terre.
En 1920 ma famille s'étant installé à Neuilly me
mit au collège Sainte Croix en classe de huitième. Je ferai
toutes mes études dans ce collège. Ste Croix était
dirigé alors par l'abbé Petit de Lutheville (?) et de nombreux
prêtres sympathiques.
Je n'étais pas un élève très brillant, même
médiocre. J'ai été passionné par le scoutisme
qui commençait alors. Je l'ai été 10 années,
chef de patrouille et assistant chef de groupe. J'ai calculé que
j'avais passé plus d'une année sous la tente.
Ayant échoué au bac (à cette époque moins
de 50% étaient reçus), mon père qui avait de grosses
difficultés financières jugeait inutile de continuer mes
études et je fus engagé à la Cie Ingersoll Rand,
compagnie américaine qui fabriquait des marteaux piqueurs. J'étais
une sorte de bouche-trou dans les différents services. Je me souviens
d'une grande angoisse lorsque je pensais à mon avenir, dans 10
ans à tel bureau, dans 20 ans peut-être au bureau du directeur
de service. Ma seule joie était d'aller à l'heure du déjeuner
à la piscine Molitor et m'entraîner en même temps que
Taris, le champion du monde de l'époque et qui était du
même club que moi.
***
Après deux
années de travail comme petit employé m'est arrivé
une des grandes chances de ma vie. Un de mes cousins me suggère
de faire le concours des "Bourses de pilotage" dans une école
privée financée par l'armée de l'air pour former
au premier stade les pilotes d'avion.
Ayant réussi les examens écrits et physique je suis affecté
à l'école Morane d'Aulnat, près de Clermont-Ferrand.
Je reçois le baptême de l'air le premier jour, n'ayant jamais
vu ni touché un avion de près et je suis l'entraînement
classique d'un élève pilote. Premier vol après 15
heures en double commande, puis brevet militaire au bout de six mois.
J'avais quelques difficultés avec mon moniteur Fernand Lefebvre
qui me sanctionnait toutes les petites fantaisies comme quelques glissades
en prise de terrain ou des atterrissages sur les roues (trois points?).
Il me supprimait la petite prime d'argent de poche que l'on recevait chaque
mois. Comme à cette école Morane, il y avait l'excellent
Morane 230 prévu pour l'acrobatie, je n'avais qu'un désir
c'était de faire toutes les figures d'acrobatie.
C'était avec le seul manuel de pilotage que je m'essayais aux loopings,
tonneaux etc. Pour ce faire j'allais me cacher derrière le Puy
de Dôme ou au-dessus des nuages, mais combien de descentes sur la
queue avant de réussir un Immelman.
Ce n'est qu'au dernier vol avant de quitter l'école que je fis
une démonstration au-dessus du terrain et qui me valut le premier
prix de pilotage.
En décembre 1931 engagement par devancement d'appel à Istres
pour continuer l'entraînement sur différents avions et je
suis classé "pilote de chasse", l'idéal pour tout
pilote. Dans ma chambrée d'Istres il y avait Marin la Meslée,
le Gloan, Littolf qui furent les as de la dernière guerre.
Mon meilleur souvenir d'Istres reste peut-être les gardes au poste
de police ou je pouvais admirer vers 5 heures du matin les beaux levers
de soleil de la Provence.
***
En mai 1932 je suis
affecté comme caporal-chef à la première escadre
de chasse de Chasse au Bourget et à la première escadrille
sur Nieuport 62, l'avion de chasse de l'époque, assez lent mais
très solide.
Je suis heureux d'être près de ma famille qui habitait toujours
Neuilly.
On volait très peu dans l'armée de l'air, 10 heures en été,
1ou 2 heures par mois en hiver.
A part l'entraînement aux manœuvres de chasse, c'était
toujours l'acrobatie qui me passionnait et avec le goût du risque
que l'on a à 20 ans, il fallait la faire le plus bas possible.
Petit à petit, j'arrivais à faire des tonneaux déclenchés
à hauteur des arbres, ou encore à faire des concours à
celui qui redressait une vrille le plus bas possible. Je me souviens surtout
des ressources au ras du sol ou l'on avait le "voile noir" pendant
plusieurs secondes et on se demandait alors si on emboutissait le sol
ou si ça passait.
C'était sûrement stupide de prendre de tels risques, mais
il était aussi nécessaire de ne pas avoir peur de la mort
si l'on voulait devenir un bon pilote de chasse en temps de guerre. En
fait, chaque année, un pilote se tuait à l'escadrille sur
les 10.
Ce fut une joie le jour ou mon commandant d'escadrille me fit admettre
dans les patrouilles d'acrobatie, car au Bourget lorsqu'un chef d'Etat
y atterrissait, en plus de la Garde Républicaine au sol, il y avait
une patrouille d'acrobatie qui faisait une démonstration, évidemment
le plus bas possible et avec un grand bruit de moteur et le 500 cv Hispano
ronflait à merveille. Toutes les fois le Commandant civil de l'aéroport
demandait une radiation pour ces pilotes qui enfreignaient toutes les
règles de la circulation.
Au Bourget il y avait aussi les défilés du 14 juillet. Les
40 avions de l'Escadre s'alignaient plans dans plans sur le terrain et
décollaient tous ensemble. Il valait mieux ne pas faire d'écarts
pendant ces décollages. On passait très bas au-dessus de
Paris, et la consigne était qu'en cas de panne, il n'y avait que
la Seine pour nous accueillir.
La grande affaire était chaque année le tour de France de
l'escadrille en 5 ou 6 escales. Bien que petit caporal-chef à peine
arrivé à l'escadrille, je fus désigné pour
en faire partie.
La première escale était Strasbourg. Le temps était
radieux et déjà je voyais la flèche de la cathédrale
lorsque mon moteur s'arrête brusquement. Je regarde les prés
qui pourraient me recevoir et j'en choisis un qui pourtant n'était
pas très grand. J'arrive un peu trop vite et le sol défile
sans que mes roues veuillent bien se poser. Au bout du terrain un petit
remblai que j'essaye de sauter, et c'est un choc brutal à plus
de 100 km/h. Je me retrouve au fonds d'un canal, le canal de la Bruche
ayant laissé mon train d'atterrissage sur le remblai. L'eau avait
heureusement bien amorti le choc, et sans perdre conscience, je réalise
que je suis dans l'eau.
Etant bon nageur, je débloque mes ceintures et mon harnais parachute
et je fais surface. Je monte sur la rive où il y a avait déjà
du monde, et j'étais évidemment tout trempé. L'idée
me vient alors qu'il y a des consignes très spéciales à
suivre lorsqu'on se pose en campagne, mais la notice de ces consignes
était dans un coin de la carlingue. Puisque j'étais tout
mouillé, je n'hésite pas à replonger dans le canal
pour rechercher cette foutue notice et éviter tous les désagréments
de n'avoir pas observé toutes les consignes voulues.
Sur la rive du canal, j'étale toutes les feuilles trempées
et illisibles et en attendant qu'elles sèchent je pense que je
dois récupérer mon parachute. Second plongeon et je ramène
le parachute. Et puis je pense à ma petite valise attachée
au fond de carlingue, et c'est un troisième plongeon à la
stupéfaction de tous les badauds rassemblés pour contempler
l'accident.
Je ne sais comment il y avait déjà là un journaliste
qui en fait un grand article dans les "Nouvelles d'Alsace".
C'était la première fois que mon nom figurait dans un journal
mais j'étais désolé d'avoir cassé mon avion
et raté ce voyage de l'escadrille.
Au bout de cette première année en escadrille je me rengage comme sergent grâce à mes bonnes notes: "Excellent pilote de chasse, très bon acrobate, souple et précis. Fait partie de la patrouille d'acrobatie et de la patrouille de concours de tir de la 1ere escadre. Doit devenir un pilote de grande classe. Cap. Robillon"
C'est en 1936 que la direction de l'aéroport du Bourget obtient le départ de la Première Escadre de Chasse qui est transférée d'abord à Villacoublay puis à Etampes. Cela ne me convenait guère d'être loin de Paris mais par chance j'apprends que le Capitaine Michy, mon ancien commandant d'escadrille est chargé de créer le centre de vol à haute altitude au Bourget. Avec un autre camarade de l'escadrille, l'adjudant Poiré, il me prend comme pilote. Ce centre était chargé de familiariser les pilotes à l'usage des inhalateurs d'oxygène nécessaires lorsqu'on dépasse 5000 mètres. Il fallait donc monter à 8000 mètres ou 10.000 mètres pour montrer le fonctionnement et les pannes possibles. L'avion utilisé était le Mureaux 117 qui avait un Hispano de 850 cv et qui grimpait très bien, mais c'était encore un avion dont le poste de pilotage et celui du passager était découvert et à l'air libre. Or à ces altitudes la température était généralement de -50° à -60°. Il fallait donc des combinaisons chauffantes et une sorte de cagoule car le moindre petit morceau de peau non couvert gelait très gravement et souvent malgré les bottes fourrées on avait les pieds glacés et le retour de la circulation du sang était très pénible.
Une autre fonction du centre était de faire tous les jours à 7h du matin un sondage avec deux sortes de baromètres fixés sur les haubans afin de mesurer les températures et l'humidité des nuages jusqu'à 8000 mètres de haut. Quand il faisait beau, il n'y avait pas de problèmes, mais lorsque le plafond des nuages descendait à moins de 100 mètres, il fallait d'abord monter dans les nuages en P.S.V. (pilotage sans visibilité) et les seuls instruments étaient la bille et l'aiguille. Instruments très primitifs qui avaient tendance à se coincer dans les coins lorsque le pilotage n'était pas parfait. Dans ce cas il fallait réduire le moteur, et lâcher les commandes, l'avion se stabilisait tout seul et l'on pouvait reprendre la montée. Toutefois il valait mieux être à une certaine altitude. Par mauvais temps et plafond bas le problème était de retrouver le terrain, on ne savait jamais où l'on était puisqu'on n'avait aucune aide radio pour la navigation et l'on se retrouvait parfois à 100 ou 200 km du Bourget. On utilisait le truc classique de repérer une voie de chemin de fer et lire le nom de la gare en volant assez bas. Mais combien de fois en descendant les derniers mètres le sol arrivait très noir et l'on se retrouvait face à face avec un arbre ou une maison. Dans ce cas il fallait remonter rapidement et tenter une autre percée un peu plus loin. On avait souvent de fortes émotions. Par contre on avait la satisfaction de voir le soleil tous les jours.
En regardant mon carnet de vol, je retrouve un certain voyage à Romorantin qui était un magasin de l'armée de l'air et y prendre un bâti-moteur. Je profite de ce petit voyage pour donner le baptême de l'air à un de mes mécaniciens. A Romorantin, j'installe le bâti-moteur et le mécanicien à la place arrière du Mureaux qui était découverte. Retour par beau temps à 1000 mètres. A hauteur d'Etampes, un petit coup de tabac, pas très fort. Je regarde mon passager: il était assis sur le plan fixe arrière et tenait le bâti dans ses bras. Il n'y est pas resté bien longtemps. Je réalise avec angoisse que je n'avais pas accroché le mousqueton de son parachute pour une ouverture automatique. Il ne lui restait plus que l'ouverture à main qu'il a heureusement trouvée et son parachute s'ouvre juste avant le sol (ce n'était pas mal pour un baptême de l'air!!). Le champ dans lequel il était tombé était assez grand et je me pose à coté de lui. Il avait une jambe cassée. Trouver une charrette pour le conduire à l'hôpital et je repars avec mon bâti tout cabossé.
Début 1937, mauvaise nouvelle: le Centre de vol en altitude est transféré à Istres.
La question se pose pour moi de mon avenir: rester à Istres pour finir une carrière de sous officier était exclu. Mon ambition était d'être pilote d'essai chez un constructeur d'avion et de faire des meetings comme Détroyat ou Doret, les grands pilotes de l'époque. J'ai été voir Farman où l'on me propose d'essayer un avion stratosphérique, mais l'avion était encore en construction et les Farman n'avaient pas la réputation d'être très modernes. De plus ils payaient très mal leurs pilotes d'essai.
J'avais obtenu un
rendez-vous chez Amiot, et M. Amiot m'expliqua qu'il avait déjà
un pilote d'essai mais que je l'intéresserais si je pouvais entrer
quelque temps à Air France en attendant qu'il construise des avions
de transport.
Pour entrer à Air France, on demandait le Brevet Supérieur
de Navigation - Brevet assez similaire à celui de Capitaine au
long cours pour la marine marchande: navigation astronomique et hauturière,
physique, mathématiques, etc. Renseigné par mes camarades
je décidais de préparer ce brevet et je pris 45 jours de
congé pour étudier le programme.
C'est bien la seule
fois de ma vie où j'ai travaillé autant. Près de
18 heures par jour pour "bachoter" toutes les matières.
Je fus reçu et les portes d'Air France s'ouvraient toutes grandes.
J'avais alors 800 heures de vol.
A Toulouse s'ouvrait le premier stage de formation des pilotes de ligne.
Ce stage était dirigé par Lafannechère, un ancien
pilote de la CIDNA qui avait un caractère pas très commode
et était très exigeant. C'est bien grâce à
lui que j'ai pu rester vivant dans ce métier où il y avait
souvent des accidents. Chaque année 5% des pilotes se tuaient à
Air France, ce qui justifiait un salaire assez élevé.
Après le stage de Toulouse ou l'on apprenait à décoller
sous capote en P.S.V. et à s'aligner avec des relèvements
gonio, les stagiaires et Lafannechère furent basés à
Prague pour s'entraîner sur la ligne Prague-Varsovie avec des trimoteurs
Wilbault. Il n'y avait jamais de passagers sur cette ligne car les relations
entre la Tchécoslovaquie et la Pologne étaient très
mauvaises. Après l'hiver passé à Prague, ce furent
les reconnaissances sur toutes les lignes du Réseau continental
- Londres, Berlin, Prague, Bucarest, Genève, etc.
En mai 1938, c'était mon lâcher comme Commandant de Bord
sur la ligne Lyon-Genève-Lyon sur trimoteur Fokker. L'aller et
retour se faisait dans la journée et l'intérêt de
cette ligne était d'avoir de bons restaurants de chaque côté.
En ces temps-là, c'étaient des équipages à
deux, un pilote et un radio. Mon radio Ph. Courtois dû se faire
remplacer ayant contacté une bonne crise de foie pour avoir abusé
de bons repas.
Le 31 décembre 1938, je suis désigné pour faire Paris-Prague
avec escales à Strasbourg et Nuremberg, sur Potez 62. Après
le décollage de Strasbourg, je trouve un assez mauvais temps et
fort givrage à 2000 mètres. Je mets en route le dégivrage
des plans et des moteurs, et c'est le moteur droit qui givre et qui s'arrête.
Obligé de descendre et tous les instruments de vol ne fonctionnent
plus. Il ne me reste que le compas et la bille. Je tâche de revenir
sur la vallée du Rhin, mais arrivé à 1500 mètres
je m'attendais à heurter un des sommets de la Forêt Noire
d'une seconde à l'autre. Heureusement c'est au-dessus de Strasbourg
que je perce les nuages, mais j'avais eu très chaud.
Je ramène à Paris le 1er janvier, l'avion qui était
toujours sans instruments, et on découvrit qu'il y avait eu une
erreur de montage dans le circuit d'air qui alimentait les dégivreurs
et les instruments de vol.
Pendant l'hiver 38-39, je fais presque uniquement Paris-Cologne-Berlin.
A Berlin je vois les défilés des troupes nazies et les rues
sont couvertes de drapeaux rouges avec la swastika. J'étais à
Berlin le soir de la nuit de "cristal", où on cassait
les vitrines des magasins juifs pour mieux les piller. Dans mes passagers
il y avait souvent des Juifs qui manifestèrent leur joie lorsque
je leur annonçai qu'on passait la frontière française.
J'avais assez souvent comme passager le Capitaine Stelhin, l'attaché
militaire à Berlin. Il venait souvent au poste de pilotage et l'on
zigzaguait sur la route pour identifier les terrains de la Luftwaffe et
compter les avions. Mais à son retour sur Berlin il était
désolé de constater que personne ne voulait l'écouter
dans les milieux gouvernementaux.
***
Septembre 1939, c'est
la mobilisation générale et je suis nommé sous-lieutenant
le jour de la déclaration de la guerre. J'avais le pressentiment
que les guerres tournaient mal lorsque nous les déclarions comme
en 1870.
Avec les avions d'Air France on avait formé des groupes de transport
qui étaient totalement inactifs pendant la "drôle de
guerre". Avec mon ami Raymond Tixier qui avait été
avec moi à la 1er Escadre de Chasse au Bourget, nous décidons
de faire une demande pour une unité de chasse au combat, ce qui
fut accepté.
Raymond Tixier et moi, nous nous retrouvons à Montpellier pour
l'entraînement à la Chasse et au début avril nous
sommes affectés au groupe de chasse 2/4, Escadrille des Petits
Poucets et des Diables rouges avec avions Curtiss P36 américains.
Le groupe avait été engagé depuis le début
des hostilités et avait obtenu déjà de brillants
résultats. Le Groupe est basé sur le terrain de Xaffévillers
dans les Vosges. Mes premières missions se font sur la frontière
Pirmasens-Deux Ponts et peu de rencontres avec l'ennemi. C'est au retour
d'une de ces missions qu'il m'arrive une très mauvaise aventure:
le terrain de Xaffévillers était très boueux et,
en me posant je sens les roues qui freinent dans une mare d'eau, et je
suis un peu projeté vers l'avant, et malheureusement j'appuie sur
les freins qui sont sur les pédales du palonnier, freins auxquels
je ne suis pas bien habitué et c'est le capotage brutal. La verrière
du cockpit se referme et je suis la tête en bas sans pouvoir sortir.
Je ne peux pas détacher les bretelles et les ceintures qui me soutiennent
car je serais coincé sur la tête et sans pouvoir sortir.
Ce qui rend la situation désagréable c'est qu'il y a une
forte odeur d'essence et que le moteur doit être encore rouge. Je
m'attends donc à ce que tout explose et prenne feu d'une seconde
à l'autre, et cela a duré plus de dix minutes, le temps
que l'on vienne pour soulever l'avion et me dégager.
Et puis c'est le 10
mai: le terrain est bombardé, mais sans trop de mal, à 5h
du matin alors que nous sommes encore au lit. Le Commandant Borne décide
de mettre une patrouille de 2 avions en alerte au sol et une autre en
vol pour la protection du terrain. Je suis donc en alerte au pied de mon
avion lorsqu'un planton arrive en courant et me tend un ordre de décollage:
"Partez intercepter une formation de 100 bombardiers protégés
par cinquante chasseurs qui sont au-dessus du col de Saverne".
Il paraît qu'en lisant cet ordre, je suis devenu blanc comme un
linge… mais on ne discute pas un ordre aussi idiot soit-il, et, je
décolle avec mon équipier. Heureusement les bombardiers
et les chasseurs sont déjà loin lorsque j'arrive au col
de Saverne.
Il semble que toutes les autorités, à tous les échelons,
ont perdu, avaient perdu la tête. Autre exemple: on voulait protéger
notre terrain, mais pour faire une protection permanente, on ne pouvait
mettre en l'air que deux avions. Ou il n'y a aucune attaque et cette mission
ne servait à rien, ou on rencontrait toute une formation ennemie
et on était en état d'infériorité. C'est ce
qui s'est passé pour mon ami Raymond Tixier qui était en
protection du terrain attaqué par une forte formation de Messer
109. Il y eut un bref engagement et son avion s'est mis en vrille. Or
le Curtiss avait un grave défaut: lorsque le réservoir supplémentaire
qu'on avait dans le dos était plein, l'avion étant alors
très décentré et on ne pouvait pas sortir d'une vrille.
C'est ce qui est arrivé à Tixier. Il a bien essayé
de sauter en parachute, mais il était trop bas et il n'a pu s'ouvrir.
Que ce soit à l'échelon du Groupe ou de l'Etat Major même
incohérence: de missions sans but et sans succès, deux avions
par ci, deux avions par là.
On constate qu'on est encore plus mitraillé par la DCA française
que par l'allemande. Ils sont incapables de reconnaître si un avion
est français alors ils tirent sur tout ce qu'ils aperçoivent,
d'où la légende "il n'y avait aucun avion français
dans le ciel". Au cours d'une mission de "chasse libre",
la seule mission qui permettait des résultats, c'est mon premier
combat réel. Nous attaquons une forte formation de Messerschmits
109. Je choisis un ailier et je fais l'approche classique: un fort piqué
et je remonte dans la queue du Messer qui ne peut me voir.
J'approche de lui
à moins de 50 mètres et il était si près qu'il
débordait de mon collimateur. Mais j'ai une petite hésitation
avant d'ouvrir le feu. Cela me paraissait inconcevable de détruire
un avion même ennemi.
Probablement prévenu par radio par un de ses camarades le Messer
fait un brusque retournement et je manque de lui rentrer dedans. Nous
étions si bas que je crus qu'il allait percuter le sol mais il
passe tout de même et disparaît.
Il faut savoir que la majorité des pilotes allemands étaient
très jeunes et sans beaucoup d'expérience, et dans une bagarre
nous avions un ascendant moral aussi étonnant que cela puisse paraître
lorsqu'on se croise à plus de 500 k/h.
Une autre fois dans une grande bagarre avec les Messer je me retrouve
tout seul avec 4 Messer dans le dos. Je me suis bien cru perdu car je
ne pouvais m'échapper, le Curtiss étant 100 km moins vite
que le Messer. Dès que je voyais un Messer qui arrivait dans ma
queue, je réduisais et je virais très sec (le Curtiss virait
beaucoup mieux que le Messer). Cette bagarre m'a semblé très
longue, et pendant que je me défendais au mieux, j'ai pensé
à la chèvre de Monsieur Seguin et à me défendre
jusqu'au bout, mais les Messer se sont découragés et sont
partis. Il ne devaient pas être très forts et n'ont même
pensé qu'ils pouvaient faire une attaque par l'avant et une par
l'arrière, auxquelles je n'aurais pu échapper.
Un matin, le terrain est attaqué par tout un groupe de Messer 109
et 110 qui mitraille nos avions plus ou moins camouflés dans des
petits bois qui entourent le terrain. Le bruit des balles et des obus
est impressionnant et amplifié dans les banches des arbres. Nous
sommes tous à plat ventre et quand nous nous relevons il y a 5
Curtiss qui flambent.
Le 9 juin c'est une autre combat qui me laisse un mauvais souvenir. J'étais
ailier de Plubeau, l'as de l'escadrille avec 14 victoires et nous étions
en patrouille basse. Soudain je le vois partir en piqué vers un
Heinkel isolé, et je suis surpris par ce départ rapide comme
tout le monde de la formation et j'ai quelques centaines de mètres
de retard. Plubeau arrive dans la queue de l'avion et arrose son droit
qui prend feu. Je ne suis plus guère qu'à 150 mètres
derrière lui lorsqu'un Messer 109 fait une manœuvre audacieuse
et se place entre moi et Plubeau. J'hésite un peu avant de tirer
car le point central de mon collimateur est centré sur Plubeau
en raison de la correction de tir mais le Messer a le temps de lâcher
une rafale sur Plubeau dont l'avion prend feu aussitôt, ce qui n'est
pas étonnant car le réservoir supplémentaire qui
est derrière le pilote n'est pas protégé, et quand
il est vide, les gaz d'essence explosent à la première balle
incendiaire. Je vois Plubeau sauter et faire une longue descente en chute
libre, et je respire pour lui quand je vois son parachute, mais de quel
côté va-t-il tomber? Ce sera dans les lignes françaises
avec de bonnes brûlures dans le cou, et près du sol il est
reçu par des tirs de soldats français heureusement assez
maladroits pour le manquer. C'est bien une preuve de la panique de l'armée
française qui tire sur un parachute isolé, ce qui ne doit
pas se faire même sur un ennemi qui est désarmé.
Cet accueil par les soldats français sera aussi celui du Lieutenant
Blanc descendu quelques jours plus tard. Et cela nous met en mémoire
le drame du Capitaine Claude qui commandait mon escadrille au début
des hostilités, descendu dans un combat au-dessus de l'Alsace,
son corps criblé de balles au bout de son parachute. On avait alors
accusé un pilote allemand de lui avoir tiré dessus, mais
les aviateurs allemands ont prouvé tout au cours de la guerre qu'ils
étaient chevaleresques. C'est donc probablement des Français
qui avaient tué le Capitaine Claude.
Dans la mission de l'après-midi, après avoir protégé
un avion de reconnaissance, la formation rentre au terrain et je suis
le plus bas de la formation. J'aperçois un Henschkel (Henschel
?), un monomoteur biplace qui fait de la reconnaissance sur le front de
combat. Je le seringue copieusement, mais il est blindé et il résiste
bien tant que son pilote n'est pas touché. Il sera tout de même
abattu avec l'aide de mes équipiers.
Nous avions quitté Xaffévillers pour Orconte situé
près de Vitry le François, et détail amusant, je
découvre gravé sur une table du mess le nom de Saint Exupéry
qui occupait précédemment le terrain d'Orconte avec sa formation.
Le terrain était situé près d'un canal, et j'aimais
dans les temps libres aller à la pêche, c'était un
bon moyen de penser à autre chose qu'à la guerre et trouver
une sorte de paix. En fait ce n'était pas en vol qu'on avait le
plus peur, il y a trop de choses à faire, c'était plutôt
au sol que l'on est le plus mal à l'aise car on réalise
que l'on a peu de temps à vivre si la guerre se poursuit à
cette cadence: déjà 10 pilotes tués sur les 30 du
groupe. Ce que je trouvais le plus pénible, c'était être
en alerte renforcée, c'est à dire dans l'avion tout harnaché
et prêt à décoller. Or si le terrain était
attaqué et que l'on décolle dès qu'apparaissaient
les avions ennemis, on était sûr de se faire descendre avant
d'avoir pris de la vitesse et ces alertes renforcées duraient souvent
plus de deux heures.
Quelques jours plus tard, dans une bagarre avec des Messer 109, j'en vois
un qui part en ligne droite et à une vitesse assez réduite,
était-il blessé? Je peux le rattraper et tire quelques courtes
rafales jusqu'à qu'il parte en piqué et s'écrase
au sol.
Une chose qui nous a beaucoup handicapé, c'est de ne pas avoir
une radio convenable, nous ne pouvions guère communiquer entre
nous et encore moins avec le sol. Si le poste marchait c'était
pour entendre les Allemands mais rein en français.
Quelques missions encore et c'est la retraite. D'abord un petit terrain
pas loin d'Avord. Le moral était très bas et nous déjeunions
dans un mess improvisé. Arrive un planton avec un message. Etant
à côté du Cdt Borne, j'y jette un coup d'œil:
"faire une reconnaissance vers le nord pour repérer les formations
ennemis", une mission suicide et stupide et chacun tremblait d'être
désigné. Le Cdt Borne dit alors: "c'est moi qui ferait
cette mission". Nous essayons de le convaincre que cette mission
ne servirait à rien, mais il part et évidemment ne rentre
pas. On apprit par la suite qu'il s'était descendre près
de Dijon où sa mère habitait.
Puis c'est Perpignan, Alger, Meknès, et, fait unique, notre échelon
roulant trouve un bateau à Marseille et nous rejoint à Meknès.
A Meknès remise de décoration par le Général
Vuillemin. Il me donne la croix de guerre avec les deux citations suivantes:
"Cordier Bernard, sous-lieutenant au Groupe II/4. Officier de valeur,
courageux et brave, précédemment affecté à
une section d'avions de transport, est venu sur sa demande dans une formation
combattante. N'a cessé depuis son arrivée de se signaler
par son cran, son énergie et son audace. Pilote de Chasse ardent
totalisant 2400 heures de vol dont 55 de guerre. Dans la matinée
du 9 juin 40, au cours d'un engagement contre une forte expédition
de bombardiers ennemis, a réussi d'abattre l'un d'eux en compagnie
de ses camarades, malgré l'intervention de la chasse adverse. Le
11 juin 1940 au cours d'une attaque contre un avion de reconnaissance
ennemi, a réussi à l'abattre avec sa patrouille après
un combat acharné." (1ère et 3e victoires officielles)
"Brillant Officier Pilote de Chasse, excellent manœuvrier et
tireur remarquable, vient de donner une nouvelle preuve à sa valeur
en abattant un avion de bombardement (He 111) protégé par
une chasse très supérieure en nombre" (3 victoires
officielles plus une probable soit 4 victoires).
Je serai fait chevalier de la Légion d'honneur le 27 mars 1945
puis officier le 31 décembre 1954. Lieutenant-Colonel de réserve
le 1.1.1957.
La chasse française aura abattu plus de 1000 avions allemands, autant qu'ils en auront perdu pendant la bataille d'Angleterre. Mais le Groupe II/4 avait perdu 10 pilotes tués, 5 blessés et 1 prisonnier.
Je suis démobilisé à Meknès et je retrouve Air France relié à Marseille. Air France avait alors ouvert une ligne Vichy-Toulouse-Marseille-Lyon-Vichy. On tournait en rond dans la petite zone non occupée. En décembre 40 un plus long voyage jusqu'à Beyrouth avec escale à Tunis, sur un avion Farman quadrimoteur, un de ceux qui avaient été prévus pour l'Atlantique Sud.
Je suis le copilote du chef pilote Durmon. Le voyage se fait de nuit et dans une zone orageuse nous avons un spectaculaire coup de foudre, sur les bords d'attaque des flammes violettes, au bout des hélices des flammes vertes et dans la carlingue se forme une boule lumineuse grosse comme un ballon de football qui se promène entre Durmon et moi puis explose comme un coup de canon en laissant sur tous les instruments une légère couche de soufre.
En juin 1944, c'est
la guerre en Syrie. Le gouvernement réquisitionne 8 Dewoitine 338
pour faire une navette entre Athènes (occupée par les Allemands)
et Alep en Syrie et tous les vols se font de nuit. Le Gouvernement de
Vichy affirmait qu'aucun avion allemand ne s'était posé
en Syrie en allant vers l'Irak, or je vois un Heinkel 111 endommagé
au milieu du terrain du terrain d'Alep. On me confirme que plusieurs avions
allemands avaient été ravitaillés à Alep.
Au premier voyage un de mes trois moteurs s'arrête, heureusement
pas trop d'Athènes que je peux regagner malgré la surcharge.
On m'envoie plus tard à Rayack où est stationné un
groupe de Chasse de Dewoitine 520 et j'assiste à des beaux combats
juste au-dessus du terrain où 6 Anglais sont descendus en quelques
minutes.
A Rayack, j'ai une aventure assez ridicule: pendant un repas au mess,
un jeune Officier me prend à parti en disant que tous les pilotes
d'Air France sont des lâches. Il tombait mal puisque j'étais
le seul pilote d'Air France à avoir combattu et j'avais 4 victoires
sur les Allemands alors que lui n'en avait aucune et je suis soutenu par
mon ami Le Gloan qui était l'as de ce Groupe. Mais ce qui m'a le
plus surpris c'est que le Commandant Geille qui commandait le Groupe me
dit: "Puisque vous êtes l'offensé, vous avez le choix
des armes pour un duel". C'était tellement stupide que je
me suis contenté de lui répondre: "ma religion m'interdit
le duel" et les choses en sont restées là.
Etant à Rayack, j'ai assisté à un breefing où
les Dewoitines devaient se tenir en alerte pour protéger des bombardiers
allemands qui devaient bombarder la flotte anglaise au large de Beyrouth.
Mais les Allemands ne sont pas venus.
J'ai repris la navette entre Alep et Athènes, une quinzaine en
tout. C'est au dernier voyage que c'est posée une décision
qui est le remords de ma vie. On avait embarqué à bord de
mon avion, une vingtaine de pilotes anglais descendus par la chasse française
pour les remettre aux Allemands à Athènes. Lorsque j'étais
à peu près au-dessus de Chypre, un pilote anglais est venu
au poste de pilotage en me demandant d'aller plutôt au Caire qu'à
Athènes. J'ai hésité et refusé car j'avais
ma famille à Marseille, mon père, ma mère et ma sœur
avec ses deux enfants dont son mari avait déjà rejoint de
Gaulle à Londres, et c'est moi qui assurait la subsistance de toute
la famille.
J'ai pensé plus tard que ce n'était pas une raison suffisante
car il y avait une question d'honneur que je n'avais pas assurée.
Ces pilotes anglais ont d'ailleurs été rendu aux Anglais
en raison des conditions d'armistice qui terminaient la guerre en Syrie.
Mais deux ans plus tard, je me trouvais en Ecosse dans une base de la
RAF, un soir du 31 décembre. Il y avait une fête où
l'on buvait beaucoup et un officier anglais vient me prendre à
partie en m'insultant copieusement. Nous allions en venir aux mains lorsque
le Group Captain s'interpose et me dit; "Il ne faut pas en vouloir
à ce pilote, il a été descendu en Syrie et les Français
l'ont livré aux Allemands. Je ne pense pas qu'il était dans
mon avion et qu'il avait reconnu, mais ce mauvais souvenir se ravivait.
Fin 41 et année 42, je fais des voyages sur Dakar et en Afrique dans les territoires contrôlés par Vichy, ce qui me permettait de rapporter un peu de ravitaillement à ma famille qui souffrait bien des restrictions d'alors.
Le 13 novembre 42,
c'est le débarquement des Américains en Afrique du Nord.
On m'envoie à Vichy avec quelques autres avions pour évacuer
Pétain et son gouvernement mais il refuse de quitter la France.
Quelques jours après ce débarquement, la France étant
alors entièrement occupée, un beau matin arrive à
la maison le Commandant Manuel, l'adjoint du Colonel Pauy du BCRA de Londres,
venant inspecter les réseaux de la résistance. A midi je
veux lui offrir un bon repas dans un restaurant de marché noir
qui se trouvait un peu en dehors de Marseille. Arrivé sur place,
je constate avec ennui que ce restaurant venait d'être réquisitionné
pour servir de mess aux officiers de la Wermatch (Wehrmacht). Il était
trop tard et nous avions faim, Manuel, ma sœur et moi. Je vais alors
demander au patron s'il ne pouvait pas nous donner à déjeuner
dans un petit coin. Il va demander aux Allemands s'il ne peut pas donner
à manger à quelques amis. Les Allemands acceptent et nous
déjeunons au milieu d'un grand nombre d'Officiers allemands. Le
brave Manuel qui avait Londres quelques jours avant avait plutôt
l'appétit coupé.
C'est Manuel qui me met en liaison avec le réseau "Phatrie"
qui travaillait entre Marseille et Nice. On me charge de tout ce qui concerne
la Luftwafe. Assez vite je ne suis pas à l'aise dans ce travail,
les "boîtes aux lettres" pour remettre ces renseignements
marchaient très mal. De plus il n'y avait aucune direction dans
ce réseau. On se réunissait au Martinez de Cannes et n'importe
pouvait voir que nous étions des "résistants".
Je demande alors à
être inscrit pour un départ en Angleterre et Londres est
d'accord. Il faut dire que mon beau-frère dirigeait la section
Renseignement du BCRA.
C'est alors une longue attente avec de nombreux contre ordres en attendant
une opération Lysander. Ce qui embrouillait les choses c'est que
nous étions 3 Cordier prévus pour ce départ. Mlle
avait donné ce nom avec de faux papiers à Manuel. De plus
le Lieutenant de Vaisseau Sonneville avait aussi des pièces d'identité
au nom de Cordier pour son séjour en France. Dans les liaisons
radio on parlait beaucoup de Cordier et la Gestapo cherchait à
savoir qui ce Cordier. Ils sont venus à Air France pour voir mon
dossier et prendre une de mes photos. J'en étais averti de plusieurs
côtés que j'étais activement recherché par
la Gestapo. J'ai eu alors une chance extraordinaire. J'avais rendez-vous
avec Simon, chef de réseau à Passy. Il habitait au sixième
et j'avais la bonne habitude de ne pas prendre l'ascenseur. Arrivé
au sixième, je vois par la porte entre ouverte les longs manteaux
de la Gestapo. Je redescends aussitôt sur la pointe des pieds et
passe devant la loge de la concierge où il y avait plusieurs Gestapistes
qui heureusement ne m'ont pas vu. A la Libération on m'a montré
une petit livret de la Gestapo où il y avait tous les noms des
résistants recherchés et un Cordier figurait à la
première pas en gros caractères. Si j'avais été
pris, j'en aurai vu de dur…
Enfin le 15 juin 43,
la BBC diffuse un message indiquant la confirmation d'une opération
Lysander.
On m'indique que je dois prendre le train de 16 heures pour Compiègne.
A l'arrivée sur le quai de la gare, je reconnais Jean Ayral, un
de mes anciens scouts. Nous faisons semblant de nous ignorer mais nous
nous retrouvons quelques heures plus tard au rendez-vous dans les champs.
En attendant les avions, Jean me raconte quelques unes de ses aventures
de guerre, en particulier celle ou étant pris par la Gestapo il
put s'enfuir d'un local du boulevard Raspail où ils étaient
gardés, lui et d'autres résistants, par deux sentinelles
en armes. L'un des prisonniers demanda à aller aux toilettes et
est accompagné par une des sentinelles. Jean se précipite
sur l'autre sentinelle, l'assomme avec son propre fusil et s'enfuit vers
la porte les menottes aux mains. Des officiers allemands le voient et
lui tirent dessus mais le ratent. Il entre dans un immeuble, monte au
grenier et se cache sous une couverture. Les Allemands qui le poursuivaient
donnent un coup de baïonnette dans la couverture mais sans le toucher.
J'ai retrouvé Jean Ayral deux ans plus tard en Corse où
il organisait un petit commando qu'on devait parachuter à Toulon
quelques jours avant le débarquement en Provence. Ce qu'il fit
et à l'approche des troupes françaises il s'installa dans
un immeuble à un croisement de routes et commence à canarder
les Allemands dans leur dos, ceux-ci se croyant contournés se replièrent.
Alors Ayral descendit sur la route en faisant le V de la victoire, mais
une balle française le tua sur le coup.
Vers 22 heures, deux Lysander arrivent au-dessus du champ qui avait été
choisi. 3 lampes torches disposées en L indiquent le sens d'atterrissage,
les 2 lampes da la base indiquent là où l'avion doit toucher
des roues. Je monte dans l'avion piloté par le Po McCairns (nuit
du 15 au 16 juin 43, nom code: NICOLETTE, terrain "Pêche",
NO de Compiègne, Hugh Verity, note lepeps) et après une
heure et demie de vol, il se pose à Tangmer. Pas de flak ou presque,
les pilotes étaient bien renseignés sur l'emplacement des
batteries qu'ils savaient évités. On me fait grâce
de "Patriotic School" où sont interrogés pendant
plusieurs jours ceux qui arrivent de France. On me conduit le lendemain
à l'hôtel Carlton où il y a un chef français
qui m'ouvre la chambre froide pleine de victuailles; "Prenez tout
ce qui vous fait envie". C'est le Paradis quand on a souffert des
restrictions en France. C'est aussi le grand soulagement de ne plus se
savoir recherché par la Gestapo, ne plus être obligé
de changer de domicile chaque nuit. Plusieurs mois se passent à
Londres où je rencontre Georges Libert, l'ancien chef pilote d'Air
Bleu et qui sera mon compagnon pendant tout le temps passé dans
la R.A.F.
***
Le BCRA voudrait
que nous soyons admis tous les deux au Squadron 161 de la R.A.F. qui fait
les opérations Lysander en France. Mais les Anglais font la sourde
oreille voulant garder l’exclusivité des opérations
leur permettant de lire le courrier de France avant de le remettre au
B.C.R.A.. Il faudra une intervention de de Gaulle auprès de Churchill
pour qu’ils admettent notre intégration, mais ce sera dans
le Squadron 148 basé à Brindisi en Italie. Avec Libert je
pars en novembre 43 pour suivre dans les différentes écoles
de la R.A.F. tout l’entraînement réglementaire. Ce seront
les stages A.F.U. à South Cernay près de Cirenster puis
le B.A.T. de Cranage.
Une parenthèse pour raconter une petite histoire assez étonnante.
En arrivant à Londres les résistants prenaient un pseudonyme
pour brouiller les pistes. On me donne celui de "Archer". Or
un de mes bons amis Pierre Pery avait fait un passage à Londres
avant mon arrivée et avait dit à une de ses amies de Londres,
Mrs Chardey, "un de mes très bons amis, Bernard Cordier, doit
arriver à Londres bientôt, traitez le aussi bien que moi".
Dans une réunion je fais connaissance de cette Mrs Chardey ignorant
qu'elle connaissait P. Pery et ce qu'il avait dit pour moi. Nous sympathisons
et elle m'invite plusieurs fois à dîner mais toujours sous
le nom d'Archer. Or un soir, elle me dit:" ne seriez-vous pas Bernard
Cordier?". Très surpris qu'elle ait pu découvrir mon
véritable nom alors sue le secret était de rigueur pendant
la guerre. Je luis demande comment elle a découvert mon nom. Elle
me dit qu'elle est allée récemment dans une réunion
de spirites et avait demandé au médium ce qu'était
devenu Bernard Cordier. Le médium lui dit; "mais vous l'avez
reçu hier à dîner".
Intrigué par cette histoire de spirites, je lui demande d'assister
à une de ses séances et un jour j'y suis invité.
Autour d'une table, nous sommes plusieurs dans une certaine pénombre,
le médium, en transes, se met à parler avec un curieux accent
anglais, l'esprit invoqué était d'origine espagnol !!! Il
s'adresse tout de suite à moi: ce militaire qui a un uniforme avec
de beaux galons dorés (j'étais pourtant en civil), fait
souvent des plaisanteries sur la mort… ce n'est pas convenable (en
effet dans l'aviation on aime ce genre de plaisanteries)
Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler, il s'appelle: "Dani…
Danilo… Danielou. Tu fais bien de rechercher toujours ce qu'il y
a de difficile, cela e servira dans la vie". Or Louis Danielou (le
frère du futur cardinal) était un de mes anciens scouts
à Ste Croix de Neuilly. Il avait rejoint de Gaulle en Angleterre
et après avoir servi dans les vedettes lance-torpille, on l'avait
chargé d'une mission au Maroc mais l'hydravion qu'il avait pris
s'était écrasé à Gibraltar et il avait été
tué. Il n'était connu à Londres que sous le nom de
Clamoshan?
Ensuite le médium me dit: "il y a aussi un gentleman qui voudrait
vous parler, c'est votre père (mon père était mort
quelques mois auparavant). Ne t'inquiète pour ta famille, elle
est dans la maison de campagne de l'Yonne". J'ai vérifié
plus tard que c'était exact.
Avec Libert nous recevons
notre affectation au Squadron 148 basé à Brindisi. C’est
aussi un squadron spécialisé dans les "opérations
spéciales" et qui travaille dans les pays méditerranéens.
Nous y retrouverons d ‘ailleurs les meilleurs pilotes du Squadron
161 : McCairns, qui m’avait sorti de France et Peter Vaughan-Fowler
qui sera le commandant du C. Flight. Mais c’est à nous de
trouver nos deux Lysanders. On découvre qu’il y en a deux
en Syrie. Ils sont quasiment réformés car ils ont fait toute
la campagne du Fezzan avec le Général Leclerc.
Toujours avec Libert nous partons pour la Syrie en mars 1944 et on nous
montre les deux vieux Lissy – à peu près retapés.
Nous les convoyons jusqu’à Alger où on refait les entoilages
pourris et où on installe l’échelle extérieure.
On ne savait pas l’âge ni les révisions des moteurs
Hercules sans soupapes, mais nous avions vu qu’ils consommaient pas
mal d’huile. Nous rejoignons le Squadron 148 à Brindisi où
on nous installe des réservoirs supplémentaires sous le
ventre du fuselage.
Enfin fin avril 44 nous sommes " opérationables ".
Ces opérations d’atterrissages en pays ennemi sont assez rares
parce que longues à préparer : il faut faire venir du pays
visé un opérateur susceptible d’être capable
de trouver un terrain et d’organiser l’atterrissage et le renvoyer
chez lui lorsqu’il aura été formé. Cet entraînement
se fait en Angleterre. Lorsqu’il aura trouvé un terrain ad
hoc, ce terrain sera ensuite photographié par un avion spécial
en photo aérienne. Puis la R.A.F. donnera son accord et c’est
par radio qu’on indiquera le jour de l’opération.
Le C. Flight fait mouvement sur Bastia en Corse d’où partiront
les opérations vers la France.
Ce sera le 10 juillet
44 que Libert et moi sommes désignés pour une double opération
sur le terrain "Figue" qui est situé à 20 km NE
de Lyon ; tout à côté du champ de manœuvre de
la Valbonne.
Vers 23 heures c’est Libert qui décolle le premier du terrain
de Borgo et je le suis aussitôt. Décollage pénible
car le Lysander malgré ses 800 CV est chargé de 3 passagers
et d’un réservoir de 200 litres. Je me traîne à
100 m d’altitude au second régime car les volets de bords
d’attaque refusent de rentrer. Je ne peux même pas passer les
petites collines du Cap Corse mais après un piqué jusqu'au
ras des vagues, les volets rentrent et le Lissy veut bien prendre l'altitude
de 3000 mètres. Vol sans histoire au-dessus de la vallée
du Rhône. Très peu de flak. On voit seulement quelques petites
boules oranges qui semblent monter assez lentement mais tout de même
passent très vite lorsqu’elles arrivent à hauteur de
l’appareil.
Vers 2 heures du matin nous tournons autour du point de rendez-vous, mais
sans voir les 3 lampes torches qui indiquent le lieu de l’atterrissage,
ni la lettre en morse du code.
Après 15 ou 20 minutes de vol nous décidons de retourner
à Bastia ce qui fera 6 h de vol pour rien.
A Bastia on a pu avoir un contact radio avec Lyon et nous décidons
de repartir le soir même.
Les 3 passagers de chacun des avions n’étaient pourtant guère
enthousiastes de passer une seconde nuit dans le Lysander, debout et serrés
comme dans une boîte de sardines. Cette fois-ci nous avons un beau
repère sur la côte française. Toulon venait d’être
bombardé par les Américains et on voyait les flammes dès
le décollage.
Arrivés au lieu de rendez-vous, le balisage était bien en
place: 2 lampes torches fixées sur des piquets indiquent là
où il faut toucher des roues, et la troisième à 110
m indiquait le sens de l ‘atterrissage face au vent. Georges se pose
le premier et je tourne au-dessus du terrain en attendant qu’il redécolle.
Je constate alors qu’il y a beaucoup d’activité sur le
champ de manœuvre de la Valbonne, les Allemands faisant des exercices
de nuit avec tirs réels et fusées multicolores.
Voyant que Georges ne repartait pas et le sol m’envoyant la lettre
du code en morse, je me pose à mon tour et Georges vient me dire
: "J’ai calé mon moteur et vidé ma batterie. Rien
à faire.".
Il faut savoir que le moteur Hercules était excellent mais avait
le défaut particulier aux moteurs sans soupapes: il refusait absolument
de démarrer lorsqu’il était chaud. Alors attendre 2
h qu’il refroidisse et la batterie à plat ? Les Allemands
de la Valbonne avaient peut-être entendu les 2 avions et allaient
arriver sans tarder.
Il fallait partir au plus vite. On demande à l’agent chargé
de l’opération de mettre le feu à l’avion dès
que tout le monde aura quitté le terrain et Georges monte à
la place arrière de mon avion.
Le Lysander était beaucoup plus léger, je prends le cap
direct vers la Corse en survolant toutes les Alpes. La nuit était
très belle et j’admirais les sommets neigeux lorsque à
hauteur de la Barre des Ecrins je découvre un ruisseau d’huile
qui coule entre mes jambes.
Panne possible et peut-être proche et le sol n’est guère
hospitalier. Toutes les vallées sont dans le noir le plus absolu,
la lune ayant disparu.
Pas question de sauter en parachute. Le passager n’en ayant pas,
la coutume dans la R.A.F. voulait que le pilote retourne les sangles du
sien pour ne pas être tenté de s’en servir.
Je dis à Georges que nous allons avoir des ennuis et il me répond
: "J’ai perdu mon avion, débrouilles-toi avec le tien.".
Heureusement le réservoir d’huile est assez important pour
les moteurs sans soupapes et comme il se trouvait dans le dos du pilote
je pouvais sentir avec ma main la hauteur de l’huile chaude et je
constatais que le niveau ne baissait pas trop vite. En effet nous avons
pu regagner la Corse de justesse.
Au retour à Brindisi, violente rafale du Group Captain Rankin pour
avoir abandonné l'avion sans le détruire, ce qui n'était
pas facile vu les circonstances, mais un avion photo P.R.U. prouva que
l'avion avait bien brûlé. Le fermier qui nous avait accueillis
sur son champ me raconta plus tard qu'il avait été obligé
de sacrifier le seul bidon d'essence qu'il avait pour faire brûler
les 1000 litres d'essence de l'avion, et que les Allemands étaient
venus chercher un cercueil.
Ce Group Captain Rankin était franchement détesté par toute la base de Brindisi. Un jour, son avion Halifax s'écrase au décollage et prend feu. Toutes les munitions explosent dans un beau feu d'artifice et je rencontre des mécaniciens hilares… "C'est le Group Capain qui vient de se casser la gueule!" Il s'en est tout de même sorti mais quelques mois plus tard il sera cassé sans que j'en sache la raison exacte.
Nous avions un avion de liaison, un petit bimoteur Cessna et n'ayant pas d'opérations en vue, je décide d'aller au Caire avec un des pilotes chercher des pièces de rechange pour nos Lysander. Grande joie de trouver le Caire bien au dehors de la guerre et on nous conduit dans les vastes souterrains d'où on avait retiré les pierres des pyramides. On y avait installé le magasin des pièces de rechange pour l'aviation. C'était la caverne d'Ali Baba où nous avons trouvé tout ce dont nous avions besoin.
Le 14 juillet 44,
opération double au départ de Brindisi pour Almiros qui
était à une centaine de kilomètres d'Athènes,
pilote F.O. Attenborough et moi-même. Mon passager était
un Général Grec qui arrive avec trois valises. On lui fait
comprendre qu'une seule doit lui suffire, et dans le vent des hélices,
il fait le tri dans ses valises. Il fait beau, mais pas de lune, ce qui
complique un peu la navigation au dessus des régions montagneuses
de la Grèce. Je distingue tout de même le Mont Parnasse qui
est sur ma route. Nous arrivons tous les deux ensemble au dessus d'Almiros
et le problème est de descendre à l'aveuglette entre les
montagnes, mais la mer proche est un bon repère même dans
la nuit. Attenborough se pose le premier et repart rapidement. J'atterris
à mon tour et, en faisant demi-tour, je distingue un uniforme allemand,
ce qui est généralement ce que l'on craint le plus dans
ce genre d'opérations. Mais puisque le premier atterrissage s'était
bien passé et que le groupe d'accueil semble très calme,
on m'explique que n'ayant pas de passagers prévus pour le retour,
on me donne un prisonnier allemand qui encombre les partisans. C'est un
adjudant qui me semble assez paisible. Il monte donc à la place
arrière et je mets le cap sur Brindisi. A mi parcours je vois les
lampes de bord qui faiblissent donc plus de courant dans la batterie.
Donc pas d'espoir de prendre le radio-phare de Brindisi, cependant j'arrive
tout de même au dessus du terrain mais par malchance arrive aussi
tout un groupe de Halifax revenant de mission. Pas de radio pour demander
un tour d'atterrissage, pas de feux de position et plus beaucoup de d'essence
en réserve. J'arrive tout de même à me glisser entre
2 Halifax et à dégager rapidement la piste. Je trouve l'explication
de la panne de courant. Le contact général qui commande
la charge de la batterie se trouve à la place arrière et
le brave allemand qui devait s'ennuyer avait coupé le contact.
J'ai pu constater ce jour là, le "fair play" des Anglais.
Au retour de mission on avait droit à deux œufs frais, au
lieu des tristes œufs en poudre. Et on invite le prisonnier à
notre table. Je trouve cela un peu anormal, mais les Anglais me disent:
" il a dû avoir peur pendant le voyage, il faut bien le réconforter
! ".
Le terrain de Brindisi était juste au bord de la mer et il était bien agréable en été de pouvoir se baigner dans une jolie crique d'eau claire. Un jour nous avions été faire un entraînement à une quinzaine de kilomètres de notre base et nous revenions avec notre jeep toute neuve en étant près de huit passagers sur la voiture et j'étais à l'arrière du véhicule. Nous marchions à plus de 100 k/h sur une route toute droite et déserte lorsqu'une charrette débouche d'un chemin creux. Notre conducteur fait un petit écart pour l'éviter, mais la jeep qui tient très mal la route, roule d'abord sur deux roues vidant tout le monde sur la chaussée avec jambes et bras cassés. Elle se retourne complètement et je vois le bitume à quelques centimètres de mon nez, pensant être broyé mais sans sentir la douleur. Après avoir glissée sur près de 50 mètres sur la route, la jeep sort sur le bas côté, va renverser un cerisier, mais reste suspendue au dessus du fossé et je peux me dégager sans une égratignure et même pas une tache sur mon uniforme. Comment étais-je passé de l'arrière à l'avant pour me recroqueviller sous le tableau de bord? J'étais pensé que c'était la Sainte Vierge qui m'avait protégé ce jour-là.
Puis ce sera le débarquement
de Provence avec les milliers de bateaux attendant leur tour pour débarquer
leurs troupes.
Puis ce sera la libération de Paris dans les derniers jours d'août
et le 2 septembre M. Soustelle, le patron de la D.G.E.R. veut revenir
à Paris. Une bonne partie de la France est encore occupée
par les Allemands, mais aucun avion en vue! Avec le petit Cessna bimoteur
nous rejoignions Toussus et Paris.
Je retrouve avec joie ma famille après plus de deux ans d'absence,
mais ce qui m'a laissé le souvenir le plus marquant, c'était
de circuler en voiture dans Paris qui était comme un désert
car il n'y avait guère plus d'une dizaine de voitures en circulation.
Dans les mois qui suivirent nous regagnons définitivement Paris
et nous nous installons dans les bureaux de la Kriegmarine au carrefour
de la Muette. Ce sont alors des voyages à Alger, Rome, Belgrade,
Tirana soit avec le petit Cessna, soit avec un JU 52 qui était
fabriqué en France pour les Allemands. Je suis promu Capitaine.
***
En juillet 45, je
suis démobilisé et je rejoins Air France. Il faut former
et entraîner les nombreux pilotes dont AF a besoin. Ce sera d'abord
à Toulouse puis au Bourget où se crée le CPPN (centre
de perfectionnement du personnel navigant). Je dirigerai ce centre pendant
1 an avec l'aide de plusieurs pilotes expérimentés. Mais
il n'était pas possible de faire voler plus de 50 pilotes, alors
qu'on en avait convoqué plus de 100, les pilotes démobilisés
étant très nombreux, et j'avais la tâche bien désagréable
d'annoncer à un certain nombre qu'on ne pouvait pas les conserver.
En août 46, je quitte le CPPN pour devenir chef pilote du réseau
continental et pouvoir suivre les jeunes pilotes tout juste formés.
Le 23 décembre je dois ouvrir de nouveau ouvrir la ligne Paris-Madagascar,
interrompue depuis la guerre. L'avion DC3 prévu ayant eu quelques
problèmes techniques, le départ est retardé d'un
jour. On ne peut encore voler que de jour, beaucoup de terrains n'étant
pas ouverts au vol de nuit, aussi il était prévu de coucher
à Tunis, le Caire, et à Nairobi. J'arrive au soir à
Tunis et il y a beau temps prévu jusqu'au Caire. Je décide
donc, d'accord avec les passagers, de rattraper le jour perdu en volant
de nuit jusqu'au Caire. Etant passé huit jours auparavant à
El Aden, l'escale nécessaire pour ravitailler, je sais que ce terrain
est ouvert la nuit. El Aden est un terrain militaire de la R.A.F. en plein
milieu du désert de Cyrénaïque. Beau temps pour traverser
le golfe jusqu'à Bengazi où commence tout de même
une couche de stratus bas très continue qui cache tout le sol.
Le radio tente de contacter El Aden, mais pas de réponse. Je pense
que le radio-phare me permettra de trouver le terrain, mais hélas
le radio-phare est aussi muet. Il est 3 heures du matin. Après
3 heures 30 de vol, je m'estime à hauteur d'El Aden et je commence
à tourner en rond. La radio n'arrive pas à contacter d'autres
stations et lance le signal de détresse sans plus de réponse.
Je commence à m'inquiéter très sérieusement:
je n'ai plus assez d'essence pour regagner Tripoli, ni à attendre
le jour, car il me reste moins de quarante cinq minutes de vol.
Pendant que je continue à tourner en rond au dessus de mon point
estimé, et qui est très incertain, je prévois ce
qui va se passer lorsque les moteurs s'arrêteront, plonger dans
le noir et m'écraser sur une colline de sable. S'il y a des blessés,
il faudra peut-être attendre plusieurs jours pour qu'on nous retrouve.
Je pense à la commission d'enquête après l'accident
qui trouvera que j'ai été imprudent de faire ce vol de nuit
et déjà me vexe. Je n'avertis pas les passagers, il en sera
temps à la dernière minute. Pour l'instant l'hôtesse
Janine Lançon leur sert un réveillon de Noël. Après
trente minutes d'angoisse qui m'ont paru très longues, le miracle
se produisit. J'aperçois une petite lumière dans un trou
de la couche de nuages. C'est bien la piste d'El Aden qui est restée
éclairée. C'est bien un vrai miracle, car se retrouver à
l'estime à un kilomètre près du but, après
un vol de mille kilomètres sans aucun repère, c'est normalement
inconcevable. Je vois arriver vers l'avion un militaire à le démarche
incertaine et je commence à déverser sur lui toute la peur
qui m'étreint depuis plus d'une heure. Il me dit: "But Sir,
that's Christmas Night, only angels are allowed to fly".
Cela me désarme et je vais boire un verre au mess où toute
la base est réunie pour la Nuit de Noël, et sans s'occuper
des avions.
Le reste du voyage jusqu'à Madagascar sera sans autres histoires.
Le 15 mars 47, le
Nice-Paris disparaît dans les Alpes. On frète un avion pour
rechercher l'épave et le nouveau Directeur Général
d'Air France, Henri Ziegler est à bord. Dans les environs de Grenoble
on survole les montagnes et M. Ziegler me demande de prendre les commandes,
et comme je trouve qu'il frôle les sommets un peu trop près,
je lui fais signe de prendre un peu d'altitude pour ne pas être
dans les courants rabattants. Il n'en fait rien me disant qu'il connaît
très bien le vol en montagne. A plusieurs reprises je reprends
les commandes pour passer les sommets à l'altitude de sécurité
et il en paraît fort vexé.
On retrouve les débris de l'avion qui a touché une arête
et a provoqué une avalanche qui a emporté tous les corps
un peu plus bas. Sur place on recherche les corps avec des tiges pour
sonder la neige et ainsi on découvre le corps du pilote.
Le lendemain, on me fait savoir que je ne suis plus Chef Pilote, M. Ziegler
aurait dit que je suis un "froussard", ce qui est un comble
de reprocher à un pilote de ligne d'être trop prudent!
Je rentre dans les rangs et heureux de n'avoir plus de responsabilités.
J'abandonne de même la Présidence du SNOAM (le syndicat des
pilotes de ligne), n'ayant guère été défendu
par le syndicat.
Je suis affecté sur la ligne Extrème Orient qui relie Paris
à Saïgon avec un DC4.
En novembre 47, je suis sur la ligne Paris-New York avec des Constellations.
C'est alors la ligne la plus intéressante avec des avions modernes
et pressurisés qui peuvent voler à 8000 mètres au
dessus des nuages et marchent à plus de 500 k/h. Les vents sont
généralement d'ouest et obligent à faire deux escales.
Le parcours le plus direct était Paris Shannon en Irlande et Gander
en Terre Neuve. Mais souvent la météo est la plus favorable
vers le sud par Santa Maria aux Açores ou, au contraire par le
nord via Mecks en Islande. Presque tout le parcours se fait en vol de
nuit, et au dessus de l'Atlantique, on se sent bien de la terre surtout
quand on peut admirer de magnifiques aurores boréales. Le vol avec
des escales dans le sens Est-Ouest prend en moyenne de 20 à 25
heures. Par contre en Ouest-Est on a des vents généralement
favorables et on arrive à faire des vols directs en 15 heures.
Le 8 janvier 48, j'étais à New York pour un retour sur Paris
à l'aéroport La Guardia. J'arrive vers 5h de l'après-midi
et il y a une forte tempête de neige. A New York il peut tomber
un mètre de neige en quelques heures. On me dit que l'aéroport
est DGO, c'est à dire interdit à l'atterrissage comme au
décollage. En effet, dans la neige on n'y voit pas à 3 mètres.
Mais par hasard, je passe à la météo et je vois une
situation assez rare: les isobares assez serrés suivent exactement
le grand cercle New York-Paris, et les vents arrières sont estimés
à plus de 100 k/h pendant tout le parcours. J'ai une longue discussion
avec les autorités de l'aéroport et finalement on me permet
de décoller après avoir signé une déclaration
où je prenais l'entière responsabilité du décollage.
Je serai d'ailleurs le seul avion à décoller ce jour-là.
Il faisait alors nuit, et toujours dans la neige, je vais en bout de piste,
et après avoir essayé les moteurs, j'ai alors un certain
regret de m'être engagé dans cette aventure car il fait vraiment
un temps de chien.
Le décollage se passe bien et j'ai bien une moyenne de 100 k/h
de vent arrière tout au long du chemin, et le vol durera seulement
10h.15, ce qui est le record de vitesse et restera valable tant qu'il
y aura des Constellation sur cette ligne.
En général, on ne fait que 5 traversées par mois,
restant à New York deux jours complets. J'avais un studio à
New York et je m'étais fait pas mal d'amis.
Sur mon carnet de
vol, je remarque une traversée qui se terminera à Washington
le 28 février 48. L'aéroport de New York était très
encombré par suite du mauvais temps et on m'avait dérouté
sur Washington. Le vol avait été très long, plus
de 30 heures de vol, soir deux nuits blanches et tout l'équipage
était bien fatigué et nous désirions nous coucher
au plus vite.
A l'aéroport de Washington, les douaniers insistent pour que l'on
dépose le bar à la douane. Je réponds que l'avion
sera fermé à clé, et étant juste en face de
la douane, il n'y a aucun risque.
Mais le lendemain matin je vois mon avion toutes les portes ouvertes et
des bouteilles cassées tout autour. Complication avec la douane
qui m'accuse d'avoir entré des boissons alcoolisées frauduleusement.
Un employé de l'aéroport me glisse dans l'oreille que ce
sont justement les douaniers qui ont fracturés les portes et bu
tout le champagne. J'aurai tout de même droit à un procès
et à une amende de 10.000 dollars (payé par la compagnie
AF).
Le 13 mai 1948, je
reviens de New York et à l'atterrissage on me demande si je veux
bien repartir aussitôt pour aller à Tel Aviv en Israël.
Le gouvernement ne voulant pas reconnaître tout de suite l'indépendance
d'Israël avait demandé à la Cie Air France de faire
une liaison pour marquer son intérêt pour Israël. L'avion
est un DC3 tout neuf, et je retrouve à bord deux futurs ministres
d'Israël que j'avais pris à New York. Vol de nuit et la première
escale est Rome mais à Marseille je rencontre un front froid orageux
très actif. Dans l'orage l'avion est très secoué,
les grêlons font un bruit terrible et la foudre frappe par deux
fois l'appareil.
Le mécanicien et le radio, assez jeunes dans le métier,
sont terrorisés et me supplient de revenir me poser à Marseille,
ils croient que l'avion va casser en l'air. J'avais d'ailleurs peine de
le maintenir en vol. Je fais demi-tour, toujours dans l'orage, mais à
la sortie, j'ai un peu honte de faire un demi-tour, ce qui ne se fait
pas sur la Ligne. Je repars pour traverser pour la troisième fois
cet orage. Le petit bimoteur qui amenait Joseph Kessel en Israël
s'était posé à Marseille. Rome-Athènes-Tel
Aviv et son petit terrain près de la ville. C'est le lendemain
que doit être prononcée l'indépendance. Le lendemain
je me rends au terrain où il y a une forte agitation et des bruits
de mitrailleuses. En effet des Spitfires égyptiens attaquent le
terrain et mon avion est la cible principale. J'ai peine à aller
voir les dégâts entre deux attaques et à la fin de
la matinée, je compte 80 impacts mais il n'a pas brûlé.
Aucun moyen de réparation sur place et je suis obligé d'abandonner
l'avion.
***
Un jour en me posant
à Orly, je réalise qu'il y 3 jours que je suis parti de
cette piste pour New York et en revenir, et il ne reste plus rien de ce
voyage. Est-ce que parcourir des milliers de kilomètres donne un
motif valable à ma vie? Je suis pourtant un grand favorisé:
j'ai un métier qui me passionne et qui est bien payé, beaucoup
de liberté entre les voyages. Une certaine considération
que donne le métier de pilote et qui flatte un peu la vanité.
Je sais que je suis considéré comme un des meilleurs pilotes
de la Compagnie et mes camarades ont une certaine estime pour moi puisqu'ils
m'ont désigné par deux fois comme président de leur
association.
Mais cela ne donne pas un sens suffisant à une vie. La religion
ne compte plus beaucoup pour moi, m'en étant écarté
pour vivre des aventures sentimentales et ne pas avoir de remords.
Je souhaitais me marier et avoir une famille, mais devenu très
difficile je ne trouvais pas le femme avec qui passer toute une vie. Il
y avait pourtant bien des hôtesses sympathiques. Ce sera le 15 août
1948 que la réponse m'en sera donné par le Ciel.
Je descendais dans les mêmes palaces et restaurants que les milliardaires
et je pouvais dire que je connaissais toutes les boites de nuit de New
York, Los Angeles… Ayant plusieurs jours de liberté avant
le prochain courrier, au lieu d'aller les passer à la campagne
chez des amis, je préfère rester à la maison où
je suis tout seul. J'achète quelques provisions et je ferme les
volets de l'appartement pour me trouver en quelque sorte en dehors du
temps.
J'avais de bons livres et je lisais tranquillement celui de Lecomte de
Nouÿ qui parlait des origines du monde et de son évolution.
C'est alors que j'ai une sorte d'illumination:
"Dieu existe bien. Il est tout. Et je n'existe que par Lui, et il
m'aime, moi particulièrement"
Mieux qu'une vision ou que des paroles, c'est une certitude qui envahit
tout mon être et une évidence que je ne peux discuter.
Après une heure de profonde émoi, je m'engage devant lui
à lui consacrer toute mon existence.
Mais je réalisais
bien que cela ne pouvait se faire du jour au lendemain, et je me donnais
un maximum d'un an et demi pour le réaliser, c'est à dire
Pâques 1950.
Puisque Dieu devenait ma seule raison d'être, il fallait que j'organise
ma vie en conséquence.
J'allais voir le Père Congar, le théologien qui était
au Saulchoir, la maison d'études des Dominicains à Soisy-sur-Seine.
Il me donna le conseil de m'installer à "L'eau vive",
une maison d'accueil dépendant de leur monastère. Cette
propriété avait été celle de la Pompadour,
puis celle du Général Gouvion St Cyr. On me donna une chambre
dans une petite maison au milieu du parc. Cette chambre était au
second alors que le premier était occupé par Jacques Maritain,
le philosophe, avec sa femme et sa belle-sœur. Au rez de chaussé
il y avait Alain Peyrefitte, le futur ministre qui venait de se marier
et de se convertir.
A l'Eau vive, je trouvais tout ce qui m'était nécessaire,
un milieu religieux et la possibilité de découvrir vers
quel institut religieux je pourrais entrer. Car une vocation tardive (j'avais
37 ans) pose pas mal de problèmes.
Je continuais mes vols sur New York et, entre deux voyages j'étudiais
la Bible et tout ce qui se rapporte à la religion et même
assistait à certains cours donnés aux jeunes Dominicains.
***
Le 6 février,
je décolle de New York pour Gander, l'escale où on fait
le plein pour traverser l'Atlantique et l'avion est à son poids
maximum. Vers 3 heures du matin, je vais m'aligner sur la piste de départ.
Il y a une tempête de neige et le runway est très verglacé.
Au moment précis où j'atteins la vitesse de décollage,
je vois une forte baisse de pression au moteur No 4. A cette seconde,
je peux encore arrêter le décollage. Je réduis tous
les moteurs et m'arrête aux balises. Le mécanicien me demande
pourquoi j'ai arrêté le décollage, il n'a rien vu
d'anormal. Je reviens au bout de piste, et on essaye tous les moteurs
qui donnent bien leur puissance. Nouveau décollage, et c'est en
passant les balises que les moteurs 3 et 4 baissent fortement leur pression:
les hélices sont passées au grand pas.
Dans la neige nous frôlons les cimes des sapins, l'avion est au
second régime, à la limite de la sustentation et je m'attends
qu'il décroche d'une seconde à l'autre. C'est alors que
le cockpit est envahi par une épaisse fumée noire et une
odeur de cramé. Le feu qu'on n'aime pas du tout à bord d'un
avion accentue une certaine panique car normalement la mort n'est pas
loin. Je coupe le contact général puisque cela semble bien
être un court circuit, mais alors plus de lumières pour éclairer
les instruments de bord et surtout plus de radio pour signaler notre état
de détresse, et surtout qu'on n'éteigne pas le balisage.
Impossible aussi de rentrer le train qui freine l'avion. Je me traîne
autour du terrain à la vitesse minimum, virant tout doucement pour
ne pas perdre les quelques kilomètres de vitesse qui nous permettent
de tenir encore en l'air. Tous ces ennuis ont duré certainement
un quart d'heure, mais dans ce cas cela m'a semblé une éternité.
J'arrive à pose l'avion délicatement car, à pleine
charge, on devait normalement vidanger l'essence avant de se poser. L'examen
de l'avion a montré que ce sont les "booster pomp" qui
sont à l'origine de ce court circuit. Ces "booster pomp"
sont des petites pompes électriques placées dans les réservoirs
d'essence et que l'on met en route qu'au moment du décollage en
même temps que les manettes des gaz afin d'alimenter en essence
les moteurs pendant l'accélération. Pendant l'essai au bout
de piste, elles n'étaient pas en route et les moteurs donnaient
toute leur puissance au petit pas. Mais le court circuit dans une des
pompes atteint dans la liasse des fils électriques, les fils qui
commandent les pas des hélices qui sont électriques, et
les font passer du petit pas au grand pas perdant ainsi les 3/4 de la
puissance.
En mars 49, je vais prendre tout de même des vacances de neige au
col de Voza avec quelques camarades d'Air France et des hôtesses.
Mais déjà je ne peux plus me passer de la messe quotidienne
et d'une rencontre avec mon Seigneur et Dieu. A 7h. du matin alors qu'il
fait encore nuit, il me faut descendre l'ancienne piste olympique qui
est terriblement tôlée à cette heure et atteindre
le petite Eglise des Houches. Malgré le grand plaisir du ski, j'abrège
mes vacances pour aller visiter le Monastère de Hautecombe qui
me paraît bien triste en plein hiver.
Quelque temps plus tard je fais l'expérience que lorsqu'on est
suffisamment uni à Dieu on ne peut plus faire de péché
grave. Un soir dans mon studio de New York, arrive une jeune femme qui
était très amoureuse de moi, j'avais une très forte
tentation naturellement, mais un regard sur le crucifix que j'avais au
dessus de mon lit, me donne la force de résister.
J'avais alors 8700 heures de vol, c'est à dire un an dans les airs.
Un jour, me promenant
sur la Cinquième Avenue à New York, je m'arrête devant
la librairie qui est en face de l'hôtel Plazza et je vois un livre
avec la photo d'un moine. C'est le livre de Thomas Merton, moine à
l'Abbaye cistercienne de Gethseinnanie (?), "la nuit privée
d'étoiles". La trappe que j'avais éliminé au
début de mes recherches en raison de son austérité
peu humaine, me devient beaucoup plus intéressante et je me renseigne
ensuite sur les différentes Abbayes cisterciennes.
Celle d'Aiguebelle me paraît très attrayante par sa si belle
architecture du 12e siècle.
En fait ce sera Cîteaux où j'irai car on me recommande son
Abbé Dom Godefroy Belorgey, lequel me reçoit très
bien et m'invite à suivre la retraite de la Communauté en
février 50. Au jour dit, j'arrive en gare de Dijon, et par politesse
je téléphone à l'Abbaye pour avertir de ma venue,
mais le portier me dit: "on ne reçoit personne" et il
raccroche. J'ai alors une forte tentation d'aller rejoindre mes amis aux
sports d'hiver, mais comme il faut attendre deux heures le train pour
les Alpes, je pense que j'ai le temps de faire une prière à
la Ste Vierge et je prends un taxi. Je sentais que ma vocation était
en jeu.
Arrivé à Cîteaux le portier me reconnaît et
me dit: "c'est vous l'aviateur, on fait exception pour vous".
Excellente retraite par un Père Carme et je suis convaincu que
c'est bien à Cîteaux que je peux me consacrer au Seigneur.
Le père Abbé voyant que j'étais très décidé
me dit: "revenez pour la Semaine Sainte et on verra". Suivre
les offices de la Semaine Sainte dans une Abbaye vous transporte dans
un autre monde où l'on peut vivre la Passion du Christ comme un
événement actuel. Mais les aviateurs n'avaient pas dans
les milieux religieux une très bonne réputation et le Maître
des novices m'avertit que je serai d'abord "oblat" c'est à
dire sans engagement même pas la vêture de novice, et que
je pourrais partir quand je le voudrais.
Bien entendu j'accepte cette année de probation puisque j'avais
l'essentiel de la vie religieuse. J'avais exactement la vie des novices:
la Messe où on assistait à cette époque à
une moyenne de 3 Messes par jour, parfois 4 ou même 5. Il y avait
aussi les 7 offices tout au long de la journée.
Le travail manuel pendant 6 heures par jour, au potager et en été
les foins et la moisson qui se faisaient à la fourche ne connaissant
pas encore les tracteurs et autres machines agricoles. Il fallait se donner
physiquement à fond, jusqu'aux limites de ses forces, et c'était
bien une façon de prier avec tout son corps, qui, lui aussi se
donnait totalement au service du Seigneur.
On se levait tôt, à deux heures du matin. Cela ne m'était
pas trop pénible puisque j'avais l'habitude de me lever très
tôt et même de passer des nuits blanches, mais il était
difficile de résister au sommeil de 3h. à 5h. lorsqu'il
fallait étudier au scriptorium.
La nourriture était très spartiate: une soupe et un plat
de légumes, ni viande, ni poissons, ni œufs. Vers 11h. du
matin on avait un bon creux à l'estomac.
il y avait aussi le silence total, on ne communiquait qu'avec des signes
des mains, un peu comme les sourds muets. Pendant ce noviciat, j'ai eu
des problèmes avec le Père Maître des novices qui
se méfiait un peu de moi parce qu'il me trouvait moins docile que
les autres novices qui avaient 20 ans. Mais cela a été bénéfique
car il faut avoir plus de vertu pour obéir à quelqu'un qui
ne vous est pas très sympathique. C'est lorsque j'avais difficultés
que j'ai trouvé le remède: passer une demie heure près
du St Sacrement même sans faire de prière explicite, et on
retrouve la paix et le courage.
Après les deux
années de noviciat, il y a les vœux temporaires pour trois
ans et le commencement des études écclésiastiques:
philosophie et théologie, en tout cinq années.
Là encore j'ai quelques problèmes avec le professeur de
théologie. Tout se faisait en latin et si j'arrivais à lire
les manuels à peu près correctement je ne pouvais répondre
en latin aux interrogations verbales et cela m'était reproché.
Il se trouve qu'ayant été convoqué un jour pour une
période militaire je me trouvais dans le train ce Nancy où
je devais passer une visite médicale. Dans le corridor je regardais
le paysage quand soudain une sorte de voix intérieure me fait comprendre
que je dois continuer mes études pour arriver au sacerdoce.
Je n'ai donc plus de scrupules et j'insiste pour persévérer.
A l'examen final avant d'être présenté au sacerdoce
je suis interrogé pendant quatre heures sur l'Eucharistie, et ce
sujet est particulièrement délicat pour ne pas dire de bêtises.
Tout se passe bien et je suis convaincu sue le St Esprit était
avec moi.
La vie dans un monastère
trappiste est avant tout parfaitement réglée. Toujours aux
mêmes heures les offices et tout le reste suit.
On trouve tout de même le temps entre deux exercices pour venir
à l'Eglise et prier, et c'est alors qu'on retrouve la paix qui
est parfois un peu ébranlée lorsqu'on a un problème
dans la vie communautaire.
Je crois que c'est une preuve de la présence de Dieu au milieu
de la communauté pour arriver à faire vivre toute leur vie
dans un lieu clos une cinquantaine d'hommes venus de tous les horizons
sociaux et même étrangers. Seul un grand amour de Dieu fait
que non seulement on se supporte mais qu'on s'aime comme des frères
et c'est une nouvelle famille dans laquelle on est intégré.
Le Supérieur, le Père Abbé, joue un rôle capital
dans un monastère qui suit la règle de Saint Benoit. C'est
lui qui oriente la spiritualité de ses moines, qui décide
de tout ce qui concerne la vie quotidienne. C'est à lui qu'on va
confier ses problèmes. C'est encore lui qui attribue les différents
emplois pour faire marcher le monastère. L'Abbé est élu
par les moines réunis en Chapitre converti autrefois élu
à vie, mais maintenant il doit démissionner à 75
ans.
***
Le 18 mars 1961, c'est
mon sacerdoce qui sera célébré dans mon ancien collège
Sainte Croix de Neuilly par Monseigneur Le Cordier assisté par
l'Abbé du Bettellois Dom Grammont. Il se trouve que dans l'assistance,
il y a plusieurs Généraux dont Zeller et Challe (c'était
quelques jours avant le putch d'Alger).
Peu de temps après je suis envoyé au Cameroun dans une fondation
d'Aiguebelle: Grandseluc (?) qui avait des problèmes de personnel
et de finances que l'on me charge d'assainir. Ce monastère était
implanté dans la grande forêt primaire à 150 km au
sud de Yaoundé. Climat assez chaud et tropical avec de gros orages
en fin de journée.
Un jour, ayant des courses à faire à Yaoundé, je
vais dire ma messe dans la cathédrale (qui a une magnifique charpente
avec le beau bois du pays). J'étais à un petit autel isolé
et avant de commencer la Messe je suis pris d'un certain scrupule me sentant
indigne de faire venir le Seigneur et mon Dieu sur cet autel par ma seule
volonté. C'est alors que je suis comme "inondé"
d'une joie et d'un bonheur que je n'avais jamais ressenti dans ma vie.
Comment j'ai passé
plusieurs heures avec une femme nue dans mes bras.
Un jour passant à la mission d'Obout, le Père missionnaire
me demande: "Puisque vous allez à la Léproserie de
N'Den, pouvez-vous me débarrasser d'une lépreuse qui m'ennuie".
J'accepte et deux gaillards se déshabillent complètement
et partent dans la forêt. Ils ramènent la lépreuse
par les pieds et par les jambes, complètement nue. Ils la poussent
dans ma voiture à coté de ma place. Elle pousse des hurlements
et se débat. Je suis obligé de la ceinturer avec un bras
pendant que je conduis de l'autre pour qu'elle n'ouvre pas la porte. Elle
essaye de me griffer mais elle n'a plus de doigts aux main. Nous arrivons
à un barrage où des soldats me disent: "On ne passe
pas sur cette route, il y a des rebelles". Je leur dis: "dans
ce cas, prenez la lépreuse avec vous". Ils ouvrent la portière,
et, devant l'odeur ils la referment et me disent: "passez, et que
Dieu vous garde".
J'ai célébré plusieurs messes à la chapelle de N'Den. au début cela va à peu près, mais à la fin, avec la chaleur, l'odeur devient très pénible. Je resterai à Grandseluc un peu plus d'un an.
En 1963 je suis envoyé
au Zaïre à Bukavu où Cîteaux avait fait une fondation
de trappistines fournies par l'Abbaye d'Igny qui est près de Reims.
Il y avait là donc une dizaine de religieuses françaises
et j'y étais comme second aumônier chargé plus spécialement
de l'extérieur.
Bukavu au Kivu est situé au centre de l'Afrique dans la région
des Grands Lacs dont le lac Kivu est un des plus beaux. La région
est assez montagneuse et il y a des volcans encore en activité.
Le monastère est à 1600 mètres d'altitude ce qui
permet un climat très agréable entre 18 et 25 degrés
de température. Dans les premières montagnes à l'ouest
du monastère commence la grande forêt qui va jusqu'à
l'Atlantique oùil y a des éléphants et surtout les
derniers gorilles des montagnes qu'on peut voir à moins d'un quart
d'heure du monastère. A 150 kilomètres vers le nord il y
a le parc de la Rwindi, une grande réserve pour les animaux sauvages,
les lions, les éléphants et les hippopotames etc. c'est
une des plus belles d'Afrique. Lorsque j'arrive en décembre 1963,
il vient d'avoir eu un soulèvement de rebelles qui a été
assez rapidement maîtrisé à Bukavu mais un Père
blanc a été assassiné dans son Eglise à Bukavu.
C'est vers Kisangani que la rébellion durera le plus longtemps.
En juillet 64, cette fois c'est la rébellion des mercenaires qui
avaient été engagés par le Zaïre. Ils arrivent
un beau matin à Bukavu et combattent les soldats zaïrois qui
s'enfuient au Rwanda tout proche, mais par suite d'un contre ordre ils
quittent Bukavu le jour même après avoir massacré
20 soldats zaïrois qui avaient été fait prisonnier.
Quand l'armée zaïroise revient à Bukavu le lendemain
il y a plusieurs Européens tués et beaucoup de femmes blanches
qui s'étaient réfugiées dans le collège des
Jésuites seront violés devant leur mari.
Ce même lendemain un camion de soldats arrive au Monastère.
Quatre soldats en descendent et me mettent leur mitraillette sur le ventre.
Dans ce cas il faut parler et discuter et si possible faire une plaisanterie
pur les faire rire. Mais ce qui me faisait le plus peur c'est qu'ils tremblaient
beaucoup avec leur arme et je craignais qu'ils appuient sur leur gâchette
sans le vouloir. Ils s'en iront sans que je sache pourquoi il étaient
venus.
Pendant un mois c'est à peu près le calme mais on sait que
les mercenaires préparent une nouvelle offensive.
Le 4 août, je me promenais sur la route quand une voiture s'arrête
et un policier zaïrois, le revolver au poing, m'oblige à monter
dans la voiture, et à un barrage un peu plus loin s'écrie:
"J'ai arrêté un mercenaire déguisé en
prêtre". Aussitôt les soldats se précipitent avec
des bâtons et me tapent dessus. Par chance le chauffeur de la voiture
me connaissait et réussit à passer le barrage rapidement.
Le 6 août, au matin, on entend des rafales de mitrailleuses et d'armes
automatiques dont le bruit s'amplifie par écho dans les montagnes
et les balles qui passent près du monastère sifflent fort.
Nous voyons sur le route une auto mitrailleuse qui tire sur le monastère
avec du gros calibre et des balles explosives qui éclatent en touchant
les murs.
La communauté se réfugie dans un petit bâtiment et
on dit l'office malgré tout.
Plus tard on rencontre dans les couloirs des mercenaires qui veulent nous
rassurer et nous annoncent qu'ils vont passer la nuit à Murkesa.
Il doit y avoir à peu près 200 mercenaires européens
et autant de Katangais, plus tous les Européens qui s'enfuient
du pays pour regagner le Rwanda. Il y a aussi dans le monastère
de nombreuses femmes et jeunes filles qui sont venus s'y réfugier.
Le "colonel" Schram viendra nous inviter à le suivre:
"sinon vos sœurs seront violées et massacrées".
Avec la Rd. Mère Lutgarde je discute de la situation et nous allons
prier pour être finalement d'accord pour rester, nous confiant à
la Providence.
Au lendemain matin la colonne des mercenaires part vers Bukav qui est
à une vingtaine de kilomètres. Deux jours après nous
voyons arriver les premiers soldats zaïrois qui ne nous causeront
d'ailleurs aucun problème. Je leur explique que s'ils franchissent
la clôture ils risquent d'être maudits par Dieu et je leur
distribue de nombreuses médailles.
Les mercenaires se sont retranchés à Bukavu et nous restons
totalement isolés pendant deux mois avec les Pères de la
mission de Murkesa.
Un beau jour, on apprend que les mercenaires n'ayant plus de munitions
et abandonnés par ceux qui les soutenaient en Belgique, se replient
au Rwanda en abandonnant leurs armes. L'armée zaïroise revient
alors à Bukavu et son commandement lui accorde cinq jours de pillage
comme si Bukavu était une ville ennemie. Toutes les maisons seront
vidées de tous leurs meubles, frigo, radio etc.
***
Je resterai vingt
années au Zaïre, m'occupant de réparer les moteurs,
d'installer l'électricité etc. de faire les courses à
Bukavu, Kigali ou Bujumbura, mais surtout d'assurer les messes et les
conférences spirituelles. Quand je suis arrivé à
la Clarte-Dieu il y avait 10 sœurs françaises et autant d'africaines
et quand je suis reparti il y avait 20 Africaines dont la mère
Abesse.
Tous les deux ou trois ans, je retournais en France pour quelques semaines
grâce à Air France qui me donnait des billets gratuits.
Mon plus grand plaisir a été de défricher un parc
de plusieurs hectares, couper et désoucher les arbres, de mettre
de l'herbe paspalum qu'il faut planter brin par brin et aussi toutes les
fleurs qui poussent si bien dans ce climat où il n'y a pas d'hiver.
A l'occasion d'un voyage au parc de la Rwindi, j'ai pu faire l'ascension
du Nyaracongo, un volcan de 3600 mètres près de la ville
de Goma. Ce colcan avait la particularité de d'avoir un lac de
lave dans son cratère, à peu près à en dessous
de ses lèvres. Il faut y passer la nuit pour le voir dans toute
sa splendeur, la lave d'un rouge orange qui monte et descend et cela semble
une bouche de l'enfer, d'ailleurs les indigènes en ont très
peur. Mais quelques années une fissure se fera à la base
du volcan et toute la lave se répandra aux environs atteignant
aux environs atteignant même les premières maisons de Goma.
Il ne restera plus qu'un tout petit lac de lave tout au fond d'un cratère.
A coté du Nyaracongo, il y a le volcan de Niamalagica moins haut
et beaucoup plus actif. Presque chaque année il y a une éruption
dans un petit cratère. Les tremblements de terre sont assez fréquents
mais pas très forts.
A la mission de Murkesa il y a le P. Jacques Fievet, un père blanc
qui a un petit cessna pour pouvoir ravitailler les missions qui sont dans
la forêt et qui n'ont aucune route convenable. Je l'ai accompagné
en 1977 pour ramener en France son avion qui avait besoin d'une révision
générale.
***
Le bruit a couru qu'il
y avait des apparitions de la Ste Vierge à 4 ou 5 jeunes filles
à Kibeho petit village au Rwanda à partir de novembre 1981.
J'y suis allé et j'ai pu assister à 4 apparitions, 2 de
la Ste Vierge et 2 de Jésus. J'avais un œil plus critique
pour être sûr qu'elles étaient véritables et
j'en ai été convaincu car il n'est pas possible de jouer
une comédie car les apparitions duraient plus de deux heures.
J'ai pu parler aux voyantes qui sont des jeunes filles ayant une certaine
instruction. Les théologiens du diocèse reconstituaient
les conversations, d'ailleurs très simples comme une mère
qui parle à sa fille de ses problèmes de tous les jours
et les incitant à prier. J'ai retenu une épisode où
Jésus montrait à Nathalia des moments de sa Passion ce qui
bouleversait la brave fille et il ajoutait:
"Quelle autre preuve de mon amour pour les hommes aurais-je pu donner?
Ils n'ont qu'indifférence et même mépris".
Ce qui est surprenant c'est parfois les filles paraissaient s'évanouir
et elles tombaient comme une masse en avant et en arrière. Il était
très émouvant pour les spectateurs de savoir la Ste Vierge
ou Jésus à quelques mètres de soi. J'ai pu assister
à la dernière apparition le 27 novembre 89, c'était
celle d'Alphonsine (celle qui avait eu la première apparition en
81)
***
En 1983, je rentre à Cîteaux désirant y finir ma vie et à reprendre la vie de communauté. Cependant en 90 on me demande de partir au Zaïre pour faire un remplacement d'un aumônier qui doit partir en Belgique. C'est alors que je fais la rencontre extraordinaire d'Adria, c'est une brave paysanne du Rwanda totalement illétrée. Elle a reçu la visite de Jésus il y a une quinzaine d'années. Jésus lui a dit qu'elle perdrait son mari et ses quatre enfants mais qu'il lui donnerait une famille beaucoup plus grande. Elle devait recueillir tous les enfants abandonnés et orphelins ou handicapés. Ce qu'elle a fait et on s'est beaucoup étonné en se demandant comment elle arrivait à les nourrir. Quand je suis allé la voir, elle avait une cinquantaine d'enfants, les plus âgés s'occupant des bébés. Mai ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que depuis 10 années elle ne mange ni ne boit ni ne dort et pourtant elle a fort bonne mine et est même très bien en chair. Elle est très gaie et l'on sent tout de suite chez elle une grande bonté pour tous ceux qui l'approchent. Elle a déjà une si grande renommée de sainteté que le gouvernement du Rwanda a construit une route de plus de dix kilomètres pour qu'on puisse lui rendre visite.
Voici le message
de Jésus pour son prêtre Baudoin reçu par Mama Adria.
Ce message a été donné par Jésus lui-même
dans la nuit du 17 janvier 1990.
Le Seigneur veut renouveler la bénédiction sacerdotale que
tu as reçu à ton ordination et cette bénédiction
qu'il t'accorde aujourd'hui c'est pour que tu vives dans la paix durant
les années à venir.
Il veut que tu accomplisses
ton ministère dans la joie et qu'un jour tu ailles la retrouver
dans la paix et la joie du ciel. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur
t'a pardonnées. Le Seigneur dit que pour tes dernières années
il te donnera les grâces nécessaires pour que tu saches te
renouveler. Le Seigneur ne voudrait pas que tu prennes du repos comme
tu l'aurais peut-être voulu. Il voudrait te donner une mission spéciale.
S'il te laisses retourner là-bas en France c'est en vue de cette
mission: accompagner les autres spirituellement par la prière.
Dans l'Eucharistie que tu reçois, tu vas toujours accueillir tous
ceux qui par toi veulent aller à Jésus et tu vas les faire
communier en entrant dans la communion de Jésus.
Mon fils, mon fils, c'est moi le Seigneur qui vis en toi et qui demeure
en toi et accomplis le ministère du salut à travers ta personne.
Je voudrais provoquer en toi cette conviction que c'est moi qui agis lorsque
tu accomplis ton ministère selon mes vœux. Je t'accorde les
grâces que tu m'as toujours demandées et je voudrais te les
accorder surtout à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de
ta vie.
Au fur et à mesure que tu prendras en compte mes désirs
que je te donne et pour lesquels il faut prier, je me hâterai d'accorder
des grâces aux personnes pour lesquelles tu pries. Tu voudrais me
rencontrer, me voir, mais quiconque accomplit ma volonté ici sur
terre, m'a déjà rencontré. Le désir d'accomplir
ma volonté est une grande grâce, c'est déjà
le début de la vision, de la rencontre avec le Seigneur. Quant
à la souffrance que tu vas vivre dans tes dernières années,
sois en paix, ce ne sera pas un obstacle pour toi dans ta vie d'union
au Seigneur, au contraire.
Le Seigneur n'a pas voulu dire quelle souffrance.
Quand tu sentiras dans ton corps quelque chose qui te fera souffrir, ce
sera alors le début de la fin, c'est un avertissement que le Seigneur
te donne afin de te préparer à ta fin. Quand tu seras en
train de souffrir, pense à offrir cette souffrance là pour
le salut de toutes ces personnes.
Il t'arrive beaucoup de méditer, écoute ce qui monte en
toi, il y a des pensées qui surgissent en toi et qui te confirme
que nous sommes en union dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux
accroître cette grâce d'union.
les obsèques de Bernard Cordier, Père Beaudoin en religion, ont été célébrées le 18 septembre 1993 à l'Abbaye.
Nota. Dans la mesure du possible je souhaite en tant que responsable du site internet de SLHADA que les documents mis en ligne soient rédigés de la main des adhérents. C'est ce que je m'efforce de faire personnellement. A l'occasion d'une recherche sur l'Aéroforum je suis "tombé" sur ce texte autobiographique et publié par M. Henri Einsenbeis. Le parcours de Bernard Cordier, né à Lyon de surcroit, m'a vivement intéressé et j'ai pensé que pour le faire connaître le mieux était de reproduire intégralement le texte qu'il avait lui même écrit. M. Eisenbeis a bien voulu donner son accord dans un message qu'il m'a adressé le 19 décembre .... 2007. Qu'il en soit remercié.
 |
 |
 |
 |
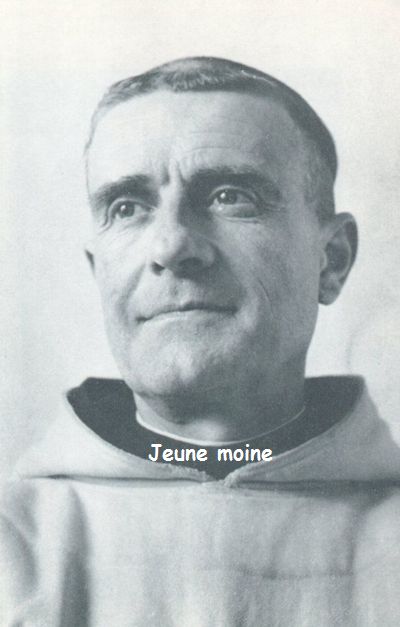 |
 |
 |
|
Bernard Cordier 1989
|
Commandant à Air France
|
Dernier vol en 1955 ?
|
Avant son entrée en religion
|
Bernard Cordier jeune moine
|
Première messe
|
En Afrique
|
|


